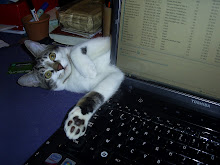skip to main |
skip to sidebar
Toujours les plaques de verre photographiques : parmi celles-ci, quatre sont consacrées à un jour de foire, dans le bourg de Guémené et deux autres mettent en image ces compagnons de tourments qu'on y acquiert.
Le photographe anonyme qui nous enchante de ces souvenirs d'il y a plus un siècle maintenant, a conservé la trace à la fois vivante et immuable de l'événement : il faisait beau, chacun avait revêtu les habits de son état, les maquignons en biaudes et canotiers, les paysannes en coiffes et longues robes noires, les "bourgeois" en costumes et melons...
Trace vivante : l'incroyable netteté de ces clichés, leur réalisme, mais aussi leur voyeurisme (ces images sont clairement dérobées à ceux qu'elles représentent) frappent le regard moderne, comme si la photographie réussissait enfin à abolir le plafond de verre séculaire du souvenir humain au-delà duquel meurent une dernière fois les amis, les parents...
Trace immuable : ces instants volés se sont figés dans l'éternité, révélant et fixant des vérités oubliées d'une époque. Leur insignifiance quotidienne même, ces scènes cent fois répétées de vies que guidait une routine sans lendemain, donnent à ces figures à peine esquissées une dimension universelle, une valeur héroïque.
Peut-on être aussi acteur de l'universel que ce photographe inconnu et laisser aussi indifférents les hommes et les femmes qu'on immortalise ? Faut-il, d'un autre côté, que le souci de laisser sa trace soit estompé par le sac et le ressac de la résignation mille fois prêchées, mille fois rabâchées par les prêtres et l'idéologie ordinaire, pour que ces êtres humains, non moins que leurs compagnons animaux, vaquent, imperturbables, sous l’œil obscène de l'objectif qui les guette...
La première photo représente un groupe de personnes et de vaches sur une portion de la place Simon, à l'entrée de la rue qui mène à la mairie, autour de l'Hôtel du Petit Joseph. Le photographe est installé à l'étage d'une maison, probablement dans le renfoncement à l'angle de la rue de l'Eglise : j'opinerais pour ce qu'on nomme aujourd'hui la maison du sabotier. On distingue d'ailleurs, en regardant bien, une enseigne en forme de sabot qui se détache du mur, en hauteur.
Au fond de la scène, une grande maison en bordure de place dans le jardin de laquelle trois personnages de dos s'apprêtent à pénétrer, et la route qui descend vers le Grand Moulin et le pont sur le Don : des carrioles désœuvrées attendent leurs maîtres.
C'est la fin d'après-midi et les ombres s'allongent vers la gauche. Sans doute les derniers prix sont-ils négociés : espoir d'une bon achat ; espoir d'une vente...
La masse noire des acheteurs, des vendeurs et des bêtes est moins indistincte qu'il n'y paraît à première vue. Des petits groupes humains discutent en regardant la "marchandise". La "marchandise" semble curieusement parfois prendre le spectateur à témoin...
La deuxième photo ressemble à une allégorie. Elle a pour décor le pont de la Rondelle et le Don. Sur la "scène" on observe quelques palis plantés, une barque. Une fois de plus, nous sommes par une belle journée ensoleillée, à la vesprée : une douce lumière dorée d'Ouest inonde les placides acteurs de cette composition.
Il y a quelque chose de l'Angelus de Millet : peut-être ce moment où le pauvre asservi à la glèbe sort un instant de sa fatale condition pour s'élever vers la spiritualité.
Toutefois, je ne crois pas beaucoup à la spiritualité des paysans mes ancêtres, en tout cas celle qui aurait pu procéder de la religion, de ses rites et de ses pompes socialement enlaçants. Pour autant, je les crois capables de s'arrêter le soir au soleil couchant, de contempler, le regard perdu vers l'Occident, le cycle journalier qui s'achève à nouveau, le miracle éternel du jour et de la nuit, la fuite du temps, la mort.
Nous faisons tous cela, après une journée âpre où le corps et l'esprit se sont asservis à des buts utilitaires, laissant vagabonder nos pensées dans la douceur d'un moment, le regard fixe qui ne fixe rien, seul avec soi-même, effleurant en pensées des concepts audacieux sur l'existence et le destin.
On pense aussi à quelque chose d'antique, de grec. Ces bœufs, ces vaches, qui se désaltèrent sont-ils promis à quelque hécatombe ? Ces femmes à la taille haute offrent leur profil hiératique et font penser à ces déesses en péplos de nos livres d'histoire.
Cette photographie où le sujet ignore superbement le photographe, saisit donc un moment de sérénité et de paix.
C'est un songe, peut-être aussi : comme dans les rêves, les rencontres sont impossibles, les personnages sont à la fois proches et incompréhensiblement inaccessibles. Des objets étranges viennent tout à coup rendre inintelligible le commun : telle cette ombrelle au très long manche posées sur le sol à droite de la scène qui semble signaler la présence d'un équilibriste non loin caché. Pourquoi ?
La troisième photo nous ramène à la foire.
Nous sommes à l'entrée orientale du bourg de Guémené, dans le dernier virage sur la route de Chateaubriand, au bas de la descente de la Butte. En toile de fond, on a l'église et un premier groupe d'habitations. Les ombres portées sur la chaussées indiquent le début d'après-midi.
Une sorte de procession descend la route : hommes, femmes, enfants, vaches.
Au plus près du photographe apparemment caché sous un porche, on distingue un groupe de trois personnes qui semblent ensemble : père, mère, fille ? La fille se retourne vers l'opérateur comme pour affirmer une connivence. Les autres poursuivent leur chemin, comme si de rien n'était. Il ne fait pas de doute qu'un instant après les trois personnages ont dû se retourner, alertés par la jeune fille.
Devant, un homme en canotier et biaude, brandissant un bâton, conduit une vache. La paire croise une femme qui remonte la rue. Plus bas, près d'un lampadaire qui semble se reculer d'effroi, un petit bonhomme en chapeau melon emmène deux bovidés presque aussi grands que lui.
Plus loin encore, des hommes qui se suivent et me font irrésistiblement penser par leur accoutrement à la publicité Ripolin d'antan, entrent dans un jardin où pend du linge. Que vont-ils faire ? Prennent-ils un raccourci ? Vont-ils plutôt pisser ou boire un coup ? J'opinerais personnellement pour cette dernière éventualité, bien dans le genre du pays.
On remarque qu'à l'entrée du bourg de Guémené se trouvait un débit de boisson, à la façon des barrières d'octroi : sans doute pouvait-on (devait-on) commencer la journée en ville par payer son écot à Bacchus...
Cette honorable maison était tenue par madame Olivon, "débitante", offrant le gîte à chevaux et carrioles, aïeule du donateur de ces photographies.
A suivre.
Quatre photos issues du lot de quarante-trois plaques de verre anciennes que je mentionnais dans le dernier article témoignent d'une fête qui a dû se tenir un dimanche de fin d'été entre 1900 et 1910.
On y voit une foule amassée au bord du Don, dans la partie plus ou moins encaissée de cette rivière qui se trouve en amont du bourg, entre Juzet et le Grand Moulin, mais à un endroit où la vallée n'est pas trop étroite pour qu'une prairie puisse s'étaler sur la rive gauche.
Trois des quatre clichés sont pris de la rive droite, alors que la foule des badauds est agglutinée sur l'autre bord du cours d'eau. Le quatrième est pris de la prairie opposée, à la fin de la fête. On verra qu'outre les photos originales, je fournis à chaque fois des zooms de ma façon.
Le soleil inonde la scène par l'ouest et il fait probablement chaud. Mais hommes et femmes sont en habits sombres. Seules les ombrelles et les canotiers sont à l'unisson de la saison.
Mais de quoi s'agit-il au juste ?
En réalité, ces photos immortalisent le souvenir de jeux qui se sont déroulés sur le Don. Au moins trois types d'épreuve se voient ou se devinent.
D'abord, une course en baquets consistant à traverser la rivière de la rive gauche à la rive droite, dans de grands baquets de bois pour la lessive, en s'aidant de ses bras et mains en guise de rames.
On a une première photo qui semble marquer le début de la course : certains participants ont visiblement du mal à décoller de la rive de départ, tandis que d'autres sont déjà bien avancés.
On aperçoit au bord de la rivière trois embarcations : l'une au premier plan et les deux autres au bord de l'autre rive, prêtes à récupérer d'éventuels concurrents en perdition.
La seconde photo semble saisir le moment où la course est terminée. Les compétiteurs rentrent "à quai". Certains sont toujours dans leur baquet, d'autres nagent au milieu de la rivière.
Voici maintenant tout autre chose. Nous sommes bien sûr toujours sur la rivière, mais cette fois-ci pour une joute nautique.
Deux barques s'affrontent : chacune comprend un champion muni d'une perche servant à désarçonner et mettre à l'eau l'adversaire, ainsi qu'un "conducteur" qui manœuvre l'embarcation en s'aidant d'une autre grande perche.
Le cliché saisit l'instant où l'un des concurrents bascule son adversaire dans la rivière. On appréciera les merveilleuses petites tenues de bain rayées de l'époque.
Il est un détail sur lequel je ne me suis pas appesanti, c'est l'espèce de poutre qu'on distingue clairement.
Quand on la scrute de près, on voit qu'elle jaillit de la rive droite d'où elle surplombe le Don, appuyée sur une sorte de tréteau plongé dans la rivière près du bord, et, qu'au bout, une sorte de plumet semble y avoir été fixé.
N'ayant pas d'autres éléments, pour cette journée, que les photos que je montre, je suis allé regarder dans la presse de l'époque.
Voici par exemple un extrait du compte-rendu de la fête du Pont Saint-Martin qui s'est déroulée à Rennes le dimanche 25 août 1901 et où il est fait mention de différents jeux sur l'eau.
On y signale, non sans réalisme et humour, un "mât horizontal sur la rivière servant aux concurrents à prendre un bain de pieds dont quelques-uns avaient besoin, avant d'aller gagner une chemise, un pantalon ou une ceinture accrochés à un cercle fixé à l'extrémité de ce mât trop consciencieusement graissé".
Au passage, cette épreuve du mât fut suivie par "par des courses en baquets, des régates".
D'autres échos de fêtes estivales dans la région de Nantes confirment la fréquence de ce genre d'amusements à cette époque.
Par exemple à Nort-sur-Erdre, le dimanche 18 août 1901 : " A 2 h 1/2 grande fête locale ; jeux divers : lâcher de 500 pigeons voyageurs ; mât horizontal sur l'eau ; courses en baquets ; courses aux canards ; jeux nautiques ; etc..."
Ou à la Haie-Fouassière, près de Vertou, le dimanche 4 septembre 1904 : " Fête annuelle des fouaces : à 1 h1/2 courses en baquets sur la Sèvre".
Et à Vertou même, tout près de Nantes, pour la fête de Beautour, le dimanche 2 septembre 1905 d'abord : " A 3 h jeux divers sur la Sèvre : mât horizontal, courses en baquets" ou bien encore le dimanche 3 septembre 1911 : " De 2 h à 4 h les jeux auront lieu sur la Sèvre : courses en baquets, courses aux canards ".
On observera au passage que d'autres jeux que ceux photographiés à Guémené sont évoqués dont, à plusieurs reprises, une course aux canards qui laisse songeur.
On peut même penser que d'autres événements festifs prenaient place ce jour-même, notamment des courses "terrestres", hippiques ou cyclistes. Des forains venaient probablement proposer leurs services.
La fête de Rennes déjà évoquée ci-dessus donne une idée : " A l'entrée de l'avenue, près de l'usine Lemoine, les baraques faisaient fureur. A côté des chevaux de bois, les pommes de terre frites, les saucisses, les gâteaux, les loteries, et ce qui valait mieux des fabriques de laitage, cailles, maingots (?), etc... qui formaient un merveilleux désaltérant au milieu de cette journée d'une chaleur accablante ".
En attendant, la foule a quitté la rive gauche du Don. Quelques notables traînent encore et se font la parlote. Au fond à droite, on distingue une toile blanche dressée autour de piquets : peut-être le "vestiaire" des athlètes qui se sont affrontés sur l'eau. Une voiture à cheval s'éloigne avec un couple, tandis que d'autres "bourgeois" et "bourgeoises" s'ébrouent. Un gros chien baguenaude.
Au premier plan, deux jeunes paysannes en tenue du pays, accompagnées d'un enfant, jouissent de la gratuité du sol pour s'y reposer encore un peu. Demain il faudra retourner trimer aux champs.
Entendez-vous l'écho fantomatique de ces joies simples sur les collines de la vallée du Don ?
Grâce à la gentillesse de la première adjointe à la Mairie de Guémené, j'ai pu récupérer quarante-trois photographies datant du tout début du XXème siècle, réalisées à l'aide de la technique de la plaque de verre commercialisée par les frères Lumières à partir de 1890.
Ces images donnent à voir un Guémené ancien, fait de foires dans le bourg, d'amusements au bord de l'eau, de familles de milieux sociaux variés. Parfois, on arrive à situer la prise de vue.
Mais, faute de documentation, les personnes ne sont pas identifiées, pas plus que l'auteur de ces témoignages, souvent magnifiques, de ce monde disparu.
J'ai choisi aujourd'hui, de vous présenter trois photos concernant des familles, deux paysannes et une plus "bourgeoise".
Naturellement, je suis preneur de tout éclairage sur ces héros oubliés.
Famille N°1 :
Il s'agit d'une grande famille composées de deux adultes et de six jeunes garçons, tous alignés devant un mur chaulé. On imagine bien le photographe donnant ses ordres, et l'on sent bien que le petit groupe n'est pas très détendu face à l'appareil photo.
Aucune joie ne s'exprime sur les visages, et l'on perçoit même une attente anxieuse (ne pas bouger), voire une incompréhension : que signifie cette prise de photo, ce loisir coûteux d'un autre monde, dont on n'est pas sûr de tirer bénéfice (récupérer le portrait de famille).
Dans le fond, il n'y a rien de naturel à faire une photo : on donne son image à quelqu'un, pour un usage qu'on ne maîtrise pas. Mérite-t-on même d'être subitement le héros, le sujet de cette image : les pauvres sont les jouets des riches.
Les parents sont encore assez jeunes (une quarantaine d'années). La femme porte la coiffe de Guémené et l'homme est vêtu d'un sarrau. Les stigmates de la vieillesse - de l'usure - commencent de marquer leurs visages.
Les enfants portent tous un sarrau sombre comme le "père". Sauf un, au premier plan, au regard sournois, en gilet et cravate.
Tous ces petits crânes sont recouverts d'une courte toison de cheveux. On perçoit plus de sérénité, face à l'objectif, auprès des deux plus âgés. Le benjamin cherche refuge auprès de son frère plus grand, blottissant sa petite tête au regard triste contre son bras.
Parfois, longtemps après, on a le sentiment que le regard bouleversé des gens photographiés porte la vision du futur qui les attend. Comme s'ils avaient vu l'échéance fatale, comme si, par le mutisme de l'image, cet avenir se révélait indicible : comment ne pas penser que ces garçons vont, dans dix ou quinze ans, connaître l'horreur des champs de bataille où leur jeunesse s'éteindra peut-être ?
La question des mains est le dernier point d'embarras de la pose : qu'en faire ?
La mère aux mains ridées de paysanne à une réponse affectueuse ; les enfants ne savent pas trop, en général, et les laissent pendre. L'un, toutefois, les rapproche gauchement sur son ventre.
Famille N°2
Nous sommes devant une maison paysanne : une porte s'ouvre sur une pièce sombre, une fenêtre, un volet, un mur vaguement crépi. Trois personnages sont debout et regardent l'opérateur (ou son appareil) : la mère, la fille et le fils. Point de mari : il est au champ ou au cimetière.
Les femmes portent la coiffe du pays. La jeune est habillée d'une robe claire à carreaux et d'un corsage "écossais". La mère est plus sobre dans son habillement : un corsage (ou une robe) sombre et un tablier uni. le petit garçon est en gilet et tient un grand chapeau de paille.
Le visage des membres de cette famille expriment des sentiments bien différents. Il y a une joie enfantine dans le pauvre et maladif sourire de la jeune fille ; une douceur et une bonté ineffable dans le regard et le port de tête de la maman ; une crispation expectative dans l'expression fermée du garçonnet. Que va-t-il advenir ?
Les mains sont à nouveau l'autre élément expressif des corps en pose. Celles de la fille, gauches et maigres, se nouent sur elles-mêmes : aurai-je un mari ? La mère exhibe son alliance et les croise doucement : caresses, famille et travail. Les petites mains encore potelées du fils, s'accroche au couvre-chef comme à une bouée.
Si le travail et la survie son sans doute au coeur de leur existence, il reste une part pour l'art, ou la beauté, la décoration, le superflu : un pot de fleur repose sur le bord de la fenêtre.
Famille N°3
Nous changeons de monde. Voici une famille aisée, du bourg probablement. Peut-être est-ce celle du photographe.
Nous nous trouvons dans un jardin clos, devant une porte de bois. Derrière la porte un autre bâtiment se devine, dont on aperçoit, en hauteur, une fenêtre à petits carreaux.
le statut social s'annonce à l'accoutrement des jeunes gens, plus varié, plus coloré, plus urbain. Sans doute aussi à cette absence d'inquiétude face à l'objectif : l'exercice photographique n'est pas nouveau, on sait ce qu'il va donner, on sait comment se comporter.
Pour l'occasion, on a sorti la grand-mère qui, à l'évidence, a un coup de mou et roupille gentiment dans le fauteuil qu'on a disposé pour elle.
Forcément cela fait se marrer les sacripants de derrière qui retiennent à peine un fou-rire en entendant les ronflements de l'ancêtre. Mais le garçonnet de gauche fait semblant de rien, et la petite fille de droite fait montre de compassion attristée.
Les garçons, vestes ou costume marin, ont de grandes oreilles décollées et quelques airs de ressemblance : nez, sourcils. La petite fille porte une jolie robe rayée à carreaux et ses cheveux sont ramenés en arrière de sa tête. Elle penche son visage vers celui de l'aïeule, en un mouvement symétrique de celui du garçon à costume marin.
La mère à l'arrière-plan a l'air de donner des consignes : "Allons, tenez-vous bien les enfants !". Et si elle porte la coiffe du pays, elle a un air d'autorité naturelle des gens qu'on respecte et qui n'ont pas à s'incliner devant le noble ou le propriétaire.
La grand-mère est aux fraises, certes. Son visage buriné, parcheminé, tanné, parcouru de rides et ponctué d'une verrue sur la joue droite, est apaisé. Gris, il est rehaussé par la coiffe d’une blancheur éclatante et le corsage noir. On distingue à hauteur d'épaules deux épingles qui fixent le devant de son habillement sombre.
Les mains savent à quoi se prendre. Celle du jeune marin tient l’accoudoir du fauteuil de la vieille endormie ; celles de la fillette, mutines, se tiennent gentiment ; celles de la douairière tricotent pour l'éternité...
A suivre.