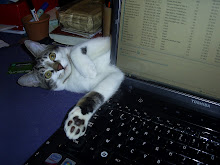Il pleut sur Guémené en cette première journée du patrimoine. J'ai consulté le programme officiel : officiellement, le seul patrimoine visitable est le château de Boisfleury. Que ses propriétaires en soient remerciés.
Quand on pense à tout ce qu'il y aurait à dire et montrer à Guémené, cela est désolant.
Alors j'ai voulu aller voir si la chapelle Saint-Yves était ouverte : mais non, là aussi porte close. J'aime bien cette chapelle qui date dans son plan actuel de 1709. Alors, je me suis arrêté pour prendre quelques photos.
Seule curiosité nouvelle, une plaque à peine discernable au dessus de la porte principale mentionne l'année 1925, peut-être l'année de quelque restauration... je ne sais. De mémoire, l'intérieur en est très beau : ce sera pour une autre fois.
Avant d'aborder plus loin dans l'article un autre sujet, je vous passe ci-dessous les clichés de Saint-Yves :
Selon ma conception des choses, le patrimoine c'est aussi les hommes et les femmes, connus et inconnus. Voici donc ma contribution à cette journée pluvieuse.
En 1943 est né à Guémené Emile Lizé. Celui-ci malheureusement est décédé prématurément le 16 mars 1988 au Canada où il était arrivé une première fois en 1966.
C'était un spécialiste de la littérature du XVIIIème siècle réputé parmi ses pairs. En 1977, ce jeune professeur fait sensation en découvrant lors d'un séjour en URSS des manuscrits inédits de Diderot.
Il renouvellera cet exploit, à la faveur d'un autre séjour en URSS, en 1987, cette fois en trouvant des oeuvres inédites du diplomate et homme de lettres bavarois ami de Diderot, le baron Grimm. La mort, survenue l'année suivante, l'empêchera d'exploiter ces documents.
Il a publié plusieurs articles scientifiques et comptes-rendus d'ouvrages concernant la littérature du siècle des Lumières, ainsi qu'un livre :
Voltaire, Grimm et la 'Correspondance littéraire' - Préface de Jean Varloot. Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, vol. 180 (Oxford: The Voltaire Foundation,1979), 253 pages.
Il semble avoir publié également, avec son épouse Diana, des livres pour enfants.
Enfin, une bourse d'études du Département de français de l'Université d'Ottawa, portant le nom d'Emile-Lizé, perpétue au Canada le souvenir de ce professeur et savant mort loin de son Guémené natal.