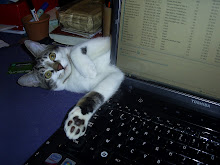Toujours soucieux de mettre en valeur le patrimoine de Guémené, je me dois, après la notice sur le château de Beaulieu, de poursuivre par un article sur le plus notable des membres de cette famille ancienne, notable en tout cas sous l'angle de l'Histoire de France, qui, comme on sait, est pour un patriote la mesure de toute chose.
Celui dont je vais vous parler n'a jamais vécu sur le territoire de notre commune, même si l'un de ses fils, comme je le mentionnais la semaine passée, entreprit la construction de l'actuel château de la Garenne à Beslé.
Toutefois, Joseph Emile François Hervé de Beaulieu est enterré au cimetière de Beslé, auprès des autres membres de sa lignée.
Il y a beaucoup de gens enterrés dans les cimetières de Guémené, Beslé et Guénouvry, et ce seul fait ne suffit donc pas à constituer une circonstance pouvant attirer l'attention des historiens locaux et du public. Ce serait trop facile !
C'est qu'en fait, Joseph Emile fut un personnage historique, de ceux dont le nom vient normalement s'intercaler dans les frises chronologiques dont on fatigue les pauvres enfants.
Vous le dirai-je enfin ? Ne l'avez-vous pas deviné ? Eh bien ce brave Beaulieu fut ministre des Contributions (autant dire du Budget ou des Finances) de Louis XVI, je dis bien XVI, oui Madame, et de surcroît au moment de la Révolution, la grande, la seule, celle qui allait ébranler les trônes, faire frémir les peuples et s'exalter les poètes.
Ce n'est pas rien, et cela mérite bien qu'on s'appesantisse un peu sur la vie de ce personnage, avant de passer en revue son oeuvre politique.
Voici donc aujourd'hui, la vie de Joseph Emile François de Beaulieu.
Jo est né à Rannée en Ille-et-Vilaine le 16 septembre 1752, et fut selon les usages de l'époque, baptisée le 19. Il était le fils de Joseph Luc Hervé, sieur de Beaulieu et de la Budrais (1711 - 1794) et d'Agathe Emilie Bigot demoiselle de Maubusson.
Il est issue d'une famille qui gravitait autour d'activités juridiques et financières. Un de ses oncles, par exemple, Jean-Baptiste, est qualifié d'avocat au Parlement, receveur des fermes du roi à la Guerche. Dans les années 1750, il était établi à Redon, où il est receveur général des fermes de Bretagne. Receveur : autant dire percepteur.
Son frère Pierre-Marie Aimée dirigea l'exploitation de la mine de charbon de Montrelais (entre Ancenis et Angers). Cette compagnie fournissait des charbons à la verrerie d'Ingrandes qui fabriquait des bouteilles pour des vins des pays de la Loire, ainsi qu'aux arsenaux et fanaux de la côte de Bretagne.
Les activités industrielles de Pierre Marie Aimée touchaient donc à un domaine (la commercialisation des vins) dans lequel son frère cadet Jo, celui qui nous intéresse, exerçait des activités fiscales et commerciales : c'est pas aujourd'hui qu'on verrait un tel mélange des genres...
Jo Emile fit un beau mariage, quoique assez tardif : il épouse en effet en 1800 la jeune Jeanne Perrine Ridouel, sa cadette de 24 ans, fille d'un receveur (percepteur) des Domaines à Acigné. Deux fils naîtront de ce mariage.
Au physique, Jo Emile était assez grand (1 mètre 78) et brun. Bien entendu, il était catholique. Ce qui ne l'empêcha pas d'être reçu frère maçon dans la loge parisienne Saint-Jean d'Ecosse du Contrat Social.
Le Vénérable en était le marquis de la Rochefoucauld-Bayers. Jo Emile y fréquenta une grosse brochette de grands seigneurs, ministres, banquiers, agents de change...
Après des études de droit, Jo Emile suivit la même voie que son père : l’administration des fermes d'impôts en Bretagne. Il devint directeur de "la ferme des devoirs de Bretagne", à Lorient, puis à Paris au début de la Révolution.
Il avait donc une longue expérience dans le domaine de la fiscalité indirecte, lorsque la protection d'amis influents lui procura, en novembre 1791, l'un des quinze emplois de commissaire du Bureau de la Comptabilité nationale dont il devint le président.
Après l'épisode ministériel, sur lequel on reviendra une autre fois, Beaulieu ne put retourner en Bretagne, faute d'avoir reçu quitus de sa gestion à la direction de la régie des devoirs de Bretagne. Au cours de cette résidence forcée à Paris, il essaya d'intervenir pour obtenir la libération des enfants du roi.
Au milieu des violences de la fin de l'été 1792 à Paris, il fut blessé à une jambe, blessure qui resta douloureuse et finit par entraîner l'amputation de la jambe à Nantes le 23 mai 1805.
Après plusieurs demandes à la Convention, celle-ci l'autorisa enfin le 21 mars 1793 à regagner le district de Redon. Il fut ensuite nommé le 10 décembre 1793 receveur du district de Blain, mais il démissionna le 20 novembre 1794 en invoquant des raisons de santé, et jusqu'à la fin de la Révolution il s'abstint de toute participation à la vie publique locale (La Terreur avait été fatale à plusieurs de ses amis...).
Beaulieu fut ensuite nommé conseiller de l'arrondissement communal de Redon par arrêté consulaire du 1er prairial an VIII (21 mai 1800). En 1803 il était conseiller général d'Ille-et-Vilaine (élu par 118 voies sur 139).
Ce n'est que peu de temps avant sa mort (à Redon le 24 septembre 1807), qu'une délibération des commissaires de la Comptabilité nationale du 3 pluviôse an XII (24 janvier 1804) lui donna quitus définitif pour sa gestion comme "ancien directeur des ferme et régie des devoirs de la ci-devant province de Bretagne à Lorient"...
Jo Emile n'était pas pauvre. Il reçut en héritage de ses parents le manoir ancestral de Beaulieu la Garenne à Beslé. Son mariage lui apporta quelques métairies en Ile-et-Vilaine. Ce qui est touchant c'est que Jo de Beaulieu se lança entre 1800 et 1805 dans la reconstitution systématique du patrimoine parental, rachetant les parts des autres héritiers.
Sa maison de Redon était meublée de façon cossue et élégante. On sait aussi, par l'inventaire après décès, qu'il faisait négoce des céréales issues de ses métairies, qu'il écoulait par la Vilaine et l'océan vers Bordeaux.
Sa maison de Redon était meublée de façon cossue et élégante. On sait aussi, par l'inventaire après décès, qu'il faisait négoce des céréales issues de ses métairies, qu'il écoulait par la Vilaine et l'océan vers Bordeaux.
En tenant compte des biens de sa femme, on peut estimer la fortune du ménage de Jo de Beaulieu entre 100 000 et 150 000 francs avec un revenu annuel correspondant de 5 000 francs environ, ce qui doit être pas mal. Difficile en effet de donner un équivalent en euros (peut-être 10 à 20 fois plus).