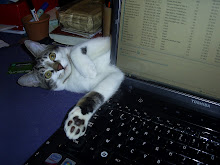Il n'était pas né à Guémené et n'y est pas mort non plus. Non, c'est à Nort-sur-Erdre, quarante kilomètres plus au Sud du département, que vit le jour et disparut Joseph Herbert.
Guémené ne fut qu'une parenthèse assez courte dans sa vie, au demeurant assez brève, mais cet épisode guémenois qui dura peut-être une dizaine d'années au début du siècle passé, a laissé une trace indélébile dans le légendaire local.
Joseph Herbert naît le 8 mars 1873. Son père est Jean Marie Herbert, commerçant âgé de 41 ans à la naissance du bébé. Il est marié à Marie Augustine Alexandrine Lemaire (34 ans en 1873) et ils habitent Basse-Grande-Rue, à Nort-sur-Erdre.
En 1896, il est toujours à Nort et vit avec son frère et une domestique. Il est dans les vins.
En 1897, le 26 octobre, il épouse Marguerite Bourdon, fille de Nort d'un an sa cadette.
Il n'a pas laissé de trace dans les archives militaires, ce qui aurait pu nous donner son aspect quand il avait vingt ans. On peut présumer que son physique lui permit de se dispenser de service militaire.
C'est probable car au début du siècle, alors qu'il approche de la trentaine, ce qui fit sa gloire est déjà avéré : Premier Prix au concours international de grosseur organisé par le Chasseur Français (plus gros poids d'Europe). Il ne dut pas prendre ce poids exceptionnel en dix ans.
Que gagnait-on ? Espérons que cela se mesurait au poids du vainqueur. Car Joseph Herbert pesait 204 kg pour 1,65 m de hauteur et un tour de ceinture de 1,78 m...
Et même 212 kg pour un tour de taille de 1, 88 m, si l'on en croit un article du 8 août 1906 paru dans l'Est Républicain. Cet organe vénérable y présente notre ami comme le plus gros pêcheur de France et lui attribue la fondation de la société de pêche guémenoise, la "Gaule du Don".
C'est par ironie affectueuse, peut-on imaginer, qu'il gagna le surnom de "Petit Joseph". Il dut à son art de cornettiste celui de "Cornet à pistons".
On disait de lui beaucoup de choses. Qu'il était professeur de danse et que sa table de cuisine avait été creusée pour qu'il puisse y mettre son ventre. On disait aussi que sa braguette comptait dix-huit boutons...
Il tenait bien sûr à Guémené "l'Hôtel des voyageurs", place Simon, renommé depuis "l'Hôtel du Petit Joseph".
Joseph Herbert quitta son hôtel et Guémené en septembre 1909. Il mourra six ans plus tard à peine, le 9 mai 1915, dans sa ville natale.
Gloire locale de Nort-sur-Erdre et de Guémené-Penfao, il a été représenté sur des centaines de cartes postales.
En voici justement six, ci-après, qui sont autant de portraits de notre héros.
Elles sont connues.
Il y a d'abord une première paire où notre héros pose devant son hôtel à Guémené, en sabots, en pantalon blanc et avec son cornet à pistons. Sans doute au retour d'un défilé de la clique de Guémené.


La seconde paire de cartes postales révèle un Petit Joseph bourgeois. Il est affublé d'un grand chapeau noir, il porte un gilet sous son veston et une chaîne lui barre la poitrine.
Pourtant, comme dans les deux photos précédentes, et celles qui suivent, il est chaussé de sabots. Il est indiqué qu'il est professeur de danse à Nort où ces deux clichés ont dû est pris.
On notera que son visage n'arbore pas la même barbe que dans les deux cartes précédentes.


Mais la tenue est moins solennelle, la casquette remplace le chapeau et le gilet a disparu. On pourrait compter les boutons de la braguettes. Croyons sans façon qu'il y en a bien dix-huit...(en fait j'en ai compté une dizaine...).
Une montre est dans une poche de la chemise dont on voit la chaîne accrochée à une boutonnière. Un petit nœud de cravate lui serre le col.
La dernière carte appartient sans doute à la même époque et le visage et la pilosité sont comparables. Il en va de même pour la tenue qui est exactement celle du Petit Joseph "bourgeois" évoquée ci-avant. Nous sommes chez un photographe, devant une toile de fond classique pour l'époque : arc de triomphe, draperie, bouquets de fleurs...


Mais si vers la fin de sa vie, le Petit Joseph tend à poser et à n'être plus que le professeur de danse vainqueur du concours de grosseur, on se souvient à Guémené du Maître d'hôtel bon vivant et joueur de cornet dans la fanfare.
Alors pour finir, une photo inédite (en tout cas je le crois), que je dois à l'amitié d'un homme qui est tout dévoué à l'histoire de Guémené et à son patrimoine.
Elle représente Joseph Herbert dans la cour de son hôtel, côté coulisses donc, faisant le facétieux.
Il est penché en avant, de profil, un visage souriant face à l'objectif, ses deux poings serrés, dans une sorte de pose de boxeur.
Il porte un chapeau blanc sur sa bonne bouille hilare. Il a la barbe et la moustache de sa dernière période. Il est boudiné dans une veste sombre et porte un pantalon clair. Il a délaissé les sabots pour des chaussures.
Un baquet et une échelle servent de décor.