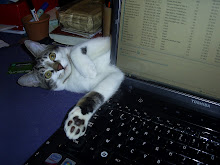Après les cartes postales colorisées du coiffeur Biziou que j'ai présentées naguère (article du 25 janvier 2015), voici celles de Mademoiselle Pinczon, toutes issues également du petit travail de collection auquel je me suis livré depuis quelque temps.
J'en possède sept qui constituent peut-être l'essentiel de la production de cette personne qui est présentée sur les cartes comme "éditeur".
Cette production se concentre sur des lieux emblématiques de Guémené (écrit avec trois accents graves dans les titres des cartes postales...) : le château de Juzet, inévitable ; la Vallée du Don, à différents endroits (Grand Moulin du bas du bourg, devant et derrière ; à Juzet) ; mais aussi des paysages "urbains" (Place Simon, Mairie, Rue de la Poste).
Ces cartes colorisées présentent une particularité par rapport à celle du coiffeur Biziou : leur aspect moiré ou strié, qui rend parfois leur examen difficile, le cliché moins précis.
Elles comportent dans plusieurs cas des animations remarquables qui, jointes à la fraîcheur (certes artificielle) des couleurs, leur confèrent une actualité et une véritable émotion.
Le château de Juzet (carte envoyée le 3 juillet 1908) :
Le cliché est pris sur l'esplanade de l'édifice, au nord-ouest. Aucune présence humaine (encore qu'à y bien regarder, une femme pourrait bien être assise sur les marches de l'entrée) ou animale ne vient compenser l'onirisme des couleurs pastel et de ce château néo-renaissant surgi de nulle part.

Le Don à Juzet (carte envoyée en 1908) :
Le point de vue se situe au sud-ouest du château, le long du Don, face au Moulin à eau qui barre le cours de la rivière. Juste après cette retenue, le Don forme un petit lac avant de reprendre son cours vers le bourg de Guémené, situé à quelques kilomètres de là en aval.
Cette carte offre un paysage factice d'été où tout semble s'être endormi sous la chaleur, dans la pénombre bienfaisante des intérieurs clos.
Heureusement, un détail révèle un peu de vie : un attelage composé d'une charrette tirée par deux paires de bœufs s'apprête à traverser la rivière à gué (on est donc bien en été, car sinon ce serait impossible).




La vallée du Don avant l'arrivée au Grand Moulin (carte envoyée en 1908) :
Du Château de Juzet jusqu'au bourg (matérialisé sur le cours de la rivière par la rencontre avec le Grand Moulin), le Don longe une crête sur sa rive nord, que l'on voit sur cette carte couronnée de bâtiments importants. En effet, cette partie surélevée du bourg ("la Butte") accueille alors l'école publique de filles, édifice ocre représenté en haut à droite.
Deux barques sont amarrées à la berge où un amas grisâtre est peut-être du bois coupé.


Le Don juste après le Grand Moulin :
La photographe a posé le pied de son appareil photographique au bout du pont qui enjambe le Don au bas du bourg de Guémené (on aperçoit un morceau de parapet gris dans l'angle inférieur gauche de la carte), d'où elle domine cette rivière dont le cours s'évase momentanément.
Outre le Grand Moulin, on aperçoit la vieille passerelle qui y conduit, par où jadis on pénétrait dans la bourgade par le sud.
Au centre du cliché, on remarque une échelle accotée au mur de la meunerie à hauteur d'une ouverture médiane. Plus à gauche, le lourd et sombre profil du toit de l'église et le clocheton du Vieux Logis médiéval se découpent sur le ciel.



La Mairie :
Le drapeau est immobile autour de sa hampe.
La façade hiératique de la maison commune se dégage à nouveau sur un ciel serein.
Une foule mi en bourgerons et chapeaux, mi en casquettes et juvénile, se presse devant le portique et les quelques marches qui conduisent à la salle principale de la mairie : est-ce jour de marché ? Est-ce jour de conseil de révision ? Les deux ?
A gauche, de dos, un individu isolé vêtu comme un maquignon regagne l'attroupement tandis qu'un autre s'apprête à sortir des vespasiennes latérales.
Pour les bons yeux, on distingue au fond à droite l'échoppe et l'enseigne de Gravaud (Jean Baptiste), sellier et bourrelier.



La Rue de la Poste :
La Rue de la Poste coupe d'est en ouest le bourg de Guémené. Celle qui donne son nom à cette artère se trouve à droite sur la carte postale. Tout près de l'école publique de garçons : voilà pourquoi sans doute apercevons-nous cette volée de jeunes écoliers en sarraus et bérets qui viennent de la dépasser.
Ils sont apparemment rabattus vers l'école par un homme en costume : serait-ce Hippolyte Martin, le fameux directeur de l'établissement scolaire ?
Au loin, tout au fond de la perspective, on aperçoit des femmes, une charrette, et encore plus loin, la belle maison du notaire et, qui pointe dans le ciel, un des moulins à vent de "la Butte".



La Place Simon :
Nous voici au coeur du bourg. La Place Simon est dépouillée de l'ancienne église. La nouvelle s'aperçoit à l'arrière-plan, inachevée avec son grand fronton noir de lattes de bois goudronnées.
Des bâtisses plus ou moins hautes en bordent le nord dont, à l'angle de la rue de l'église (la nouvelle) et de la Place, la maison Cormerais fils, mécanicien, qui égrène sur sa façade toutes les bonnes choses qu'on y peut trouver : machines à coudre, écrémeuses et faucheuses, machines à battre et pressoirs. On y répare cycles et automobiles (il y en avait quelques unes)...
Une grosse lanterne est fixée au mur à hauteur du premier étage, et l'on remarque des trottoirs : le bourg est moderne et bien équipé.
De l'autre côté de la rue de l'église, à gauche : la succursale du Bon Marché tenue par madame Leroux, chapelière dont le mari et le fils sont plâtriers.




***
Je ne sais pas qui fut exactement "Mademoiselle Pinczon". Je penche en fait pour Berthe Pinczon, née le 20 novembre 1874, à Guémené, fille de Julien Joseph Pinczon et de Marie Livinec, seule personne de ce nom qui à cette époque vive au bourg et ne soit pas mariée.
Je perds sa trace après 1906 et il est possible qu'elle soit décédée peu après, laissant une oeuvre modeste, improbable mais originale.
Originale, elle le fut assurément, pour se lancer alors dans ce passe-temps plutôt masculin, apprendre les manipulations complexes (à l'époque) de la prise de vue et du développement, faire coloriser ses épreuves, trimbaler son équipement - appareil, pied, plaques, etc... - de ci de là dans la commune sous le regard goguenard des paysans et des vaches...
In memoriam Berthe au grand pied.